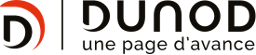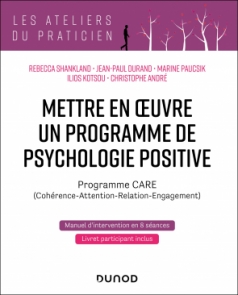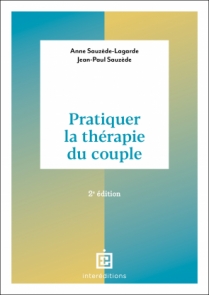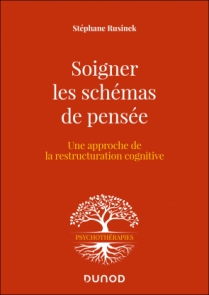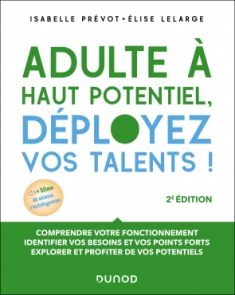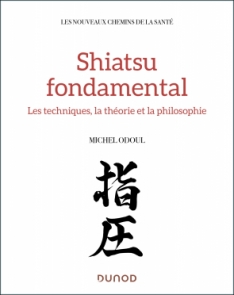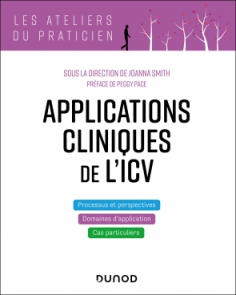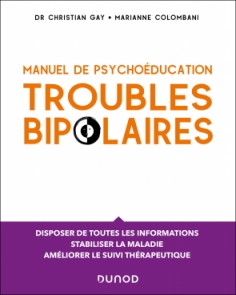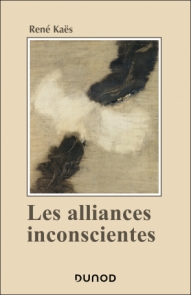Mettre en oeuvre un programme de psychologie positive - �
L’ouvrage présente le programme de psychologie positive appliquée CARE (Cohérence - Attention - Relation - Engagement). Ce programme innovant dans le domaine de psychologie...
Pratiquer la thérapie du couple - 2e édition
Couple conjugal et professionnel, thérapeutes experts de la thérapie du couple, fondateurs de l’Ecole du couple, les auteurs ont pour intention avec ce manuel de soutenir les...
Soigner les schémas de pensée - �
Les schémas de pensée désignent, dans les thérapies comportementales et cognitives, les processus cognitifs qui «filtrent» notre perception de la réalité et de notre vie....
Aide-mémoire - Méthodes de relaxation
Les méthodes de relaxation connaissent différents domaines d’application. Utilisées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en psychologie et en médecine, elles sont...
Adulte à haut potentiel, déployez vos talents ! - 2e édition
Comment mieux vous adapter ou dépasser vos limites !
Revue de l'hypnose et de la santé N°28 - 3/2024
La Revue de l'hypnose et de la santé, revue de tous les praticiens en hypnose clinique et hypnothérapie, est un véritable outil de formation et d'accompagnement, La...
Shiatsu fondamental
Première véritable synthèse écrite sur le shiatsu japonais, ce livre est majeur tant dans son contenu que dans la perspective qui est la sienne : donner la dimension réelle d...
Applications cliniques de l'ICV - �
La pratique de l’ICV est récente et en plein développement. Les psychothérapeutes qui y sont formés ont besoin de mieux connaître la diversité d’application de l’ICV, tant...
Manuel de psychoéducation
La psychoéducation propose aux patients un accompagnement personnalisé visant à améliorer le suivi thérapeutique et la qualité de vie.
Les alliances inconscientes
Les alliances inconscientes sont l’une des principales formations de la réalité psychique. Elles ont une double face.
Nos raisons de vivre - �
L'ouvrage reprend une série d'articles où l'auteur expose sa pensée et la force de son approche qui est d'aider l'homme à trouver un sens à sa vie. C'est dans l'horreur d...
Revue de l'hypnose et de la santé N°27 - 2/2024
La Revue de l'hypnose et de la santé, revue de tous les praticiens en hypnose clinique et hypnothérapie, est un véritable outil de formation et d'accompagnement, La...
- Psychothérapies (141) Apply Psychothérapies filter
- Psychismes (84) Apply Psychismes filter
- Les Ateliers du praticien (55) Apply Les Ateliers du praticien filter
- Inconscient et Culture (52) Apply Inconscient et Culture filter
- Aide-mémoire (32) Apply Aide-mémoire filter
- Transes (24) Apply Transes filter
- HORS COLLECTION (21) Apply HORS COLLECTION filter
- Soins et Psy (19) Apply Soins et Psy filter
- Les nouveaux chemins de la santé (18) Apply Les nouveaux chemins de la santé filter
- Corps et Santé (13) Apply Corps et Santé filter
- Guides d'accompagnement (8) Apply Guides d'accompagnement filter
- Santé Social (7) Apply Santé Social filter
- Les outils du psychologue (6) Apply Les outils du psychologue filter
- Développement personnel et accompagnement (5) Apply Développement personnel et accompagnement filter
- Mon cahier d'accompagnement (5) Apply Mon cahier d'accompagnement filter
- Guides Santé Social (4) Apply Guides Santé Social filter
- Le bilan avec (4) Apply Le bilan avec filter
- IDEM (3) Apply IDEM filter
- La boîte à outils des professions de la santé (3) Apply La boîte à outils des professions de la santé filter
- Lire et comprendre (3) Apply Lire et comprendre filter
- Cursus (2) Apply Cursus filter
- Découvrir (2) Apply Découvrir filter
- Dunod Poche (2) Apply Dunod Poche filter
- EKHO (2) Apply EKHO filter
- Nouvelles évidences (2) Apply Nouvelles évidences filter
- 128 (1) Apply 128 filter
- A la plage (1) Apply A la plage filter
- Collection U (1) Apply Collection U filter
- Dunod Graphic (1) Apply Dunod Graphic filter
- Epanouissement (1) Apply Epanouissement filter
- Regards psy (1) Apply Regards psy filter