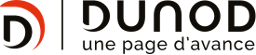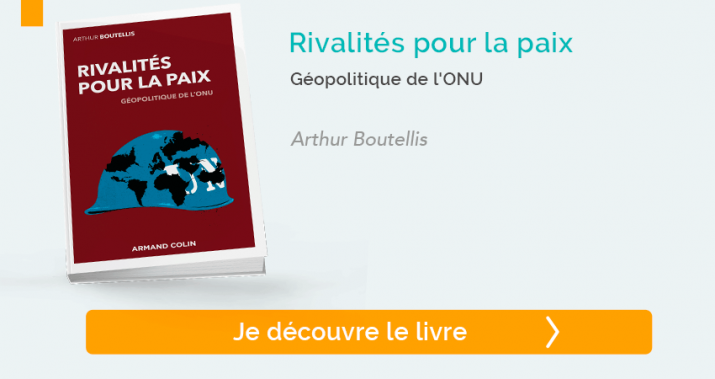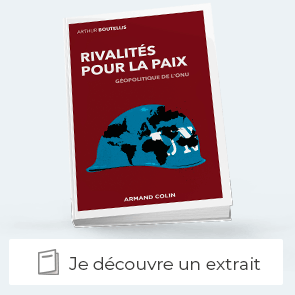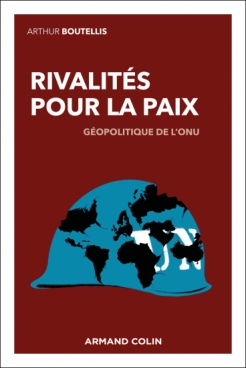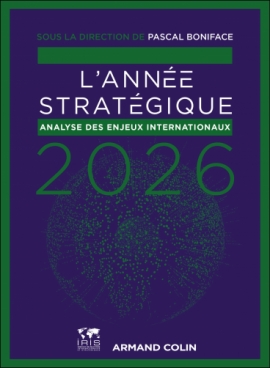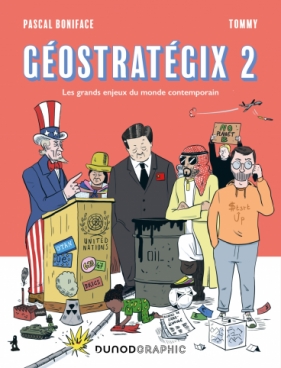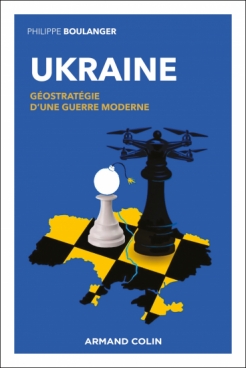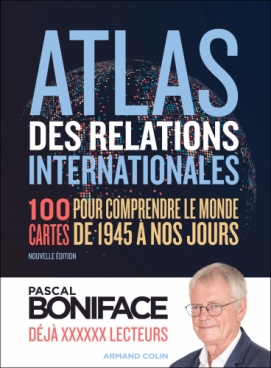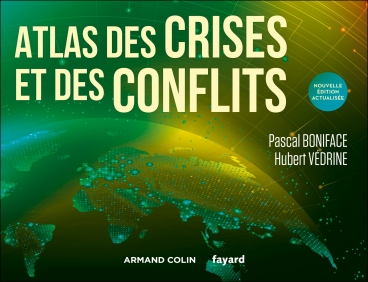Rencontre avec Arthur Boutellis qui décrypte les rivalités géopolitiques fragilisant l’ONU et son rôle unique dans la paix mondiale. Une plongée passionnante au cœur de cette institution complexe.
À l’occasion de ses 80 ans, l’Organisation des Nations Unies traverse une crise existentielle. Dans son ouvrage Rivalités pour la paix – Géopolitique de l’ONU, Arthur Boutellis, ancien fonctionnaire des Nations Unies et enseignant-chercheur en relations internationales, livre une analyse lucide et engagée d’une institution méconnue et souvent mal comprise, notamment en France.
Arthur BOUTELLIS, pourquoi avez-vous souhaité écrire ce livre Rivalités pour la paix - Géopolitique de l'ONU ?
J’ai travaillé à l’ONU pendant une dizaine d’années (2005-2015), brièvement à New York puis sur le terrain (au Moyen-Orient, au Burundi, au Chad et en Centrafrique, en Haïti, et au Mali) en tant qu’expert des groupes armés dans les opérations de paix. J’ai ensuite poursuivi une seconde carrière dans les Think Tanks (à l'International Peace Institute) travaillant avec les diplomates à New York, et en tant qu’enseignant-chercheur (à l'Université de Columbia de New York et à Sciences Po), tout en continuant de soutenir différents processus de médiation et négociations.
Avec ce livre j’ai voulu rendre accessible à un public plus large une Organisation des Nations Unies qui reste méconnue et mal comprise en France notamment, avec beaucoup d’idées reçues sur ce « machin » – pour reprendre l’expression du général de Gaulle. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, deuxième contributeur en casques bleus parmi les cinq membres permanents, derrière la Chine, et sixième contributeur au budget du maintien de la paix. Cinq Français se sont succédé à la tête du Département chargé des opérations de paix au Secrétariat de l’ONU à New York depuis 1997. Pourtant, il y assez peu de littérature en français et de débats publics sur l’ONU en France.
Je découvre un extrait du livre
Rivalités pour la paix : pourquoi avez-vous souhaité insister sur cette dualité ?
L’enjeu du livre c’est d’abord d’expliquer que les rivalités de puissance se jouent aussi à l’ONU et ce depuis la création de l’organisation en 1945. Le système multilatéral onusien a toujours été le reflet de l’ordre international dans lequel il opère, mais il est également un lieu où se jouent des rivalités de pouvoir et d’influence entre États aux intérêts et valeurs propres - d‘où le titre « rivalités pour la paix » - à travers des stratégies diversifiées de contrainte, d’influence et de résistance, que le livre aide à décrypter.
C’est aussi pour cela que je suggère que, quand bien même nous observons un durcissement des relations internationales, la France comme d’autres puissances moyennes auraient tort de ne travailler qu’avec ses amis au sein de coalitions « minilatérales » dans sa stratégie d’influence globale. En pleine guerre froide, le Secrétaire général Dag Hammarskjöld, déclarait que « ce n’est pas l’Union soviétique ni aucune autre grande puissance qui a besoin des Nations unies pour sa protection : ce sont toutes les autres ». Un monde de plus en plus « désoccidentalisé » nécessite des stratégies de pouvoir et d’influence diversifiées que le multilatéralisme permet de pratiquer.
De quelle ONU voulez-vous parler ?
Kofi Annan a qui un journaliste avait demandé si l’ONU était impuissante en Syrie, lui avait répondu par une question : « de quelle ONU voulez-vous parler ? ». C’est aussi cela qu’explique le livre : comment différents groupes d’États plus ou moins influents usent de différents leviers et alliances dans la négociation des résolutions et dans les financements de l’Organisation ; comment le Secrétaire général compose avec les puissances et à quel point la bureaucratie et les nominations sont sujettes à politisation ; et enfin comment l’écosystème des think tanks et autres organisations non gouvernementales qu’on appelle parfois la « troisième ONU » modèle aussi certaines normes et valeurs guidant le travail de l’Organisation. Sur le terrain, les États utilisent d’autres stratégies également étudiés dans le livre, au sein des opérations de paix et en parallèle de celles-ci.
L’État dont le pouvoir et l’influence se font le plus ressentir et dont l’avenir de l’organisation dépend en grande partie est la Chine. Depuis 2015 en particulier, Pékin a énormément investi dans l’ONU, profitant du désengagement des Etats-Unis. Elle a aussi accepté de payer plus, beaucoup plus. Alors qu’en 2000, la Chine ne contribuait qu’à hauteur de 1% du budget du maintien de la paix, sa contribution n’a cessé d’augmenter, atteignant environ 24 % du budget aujourd’hui et sur le point d’égaler celle des États-Unis. La Chine entend donc logiquement y peser, y placer plus de chinois, et y promouvoir sa vision du monde et du multilatéralisme, qui trouve un écho parmi beaucoup d’États dits du «Sud Global.»
L’ONU va-t-elle survivre ?
À 80 ans, l’ONU semble avoir perdu son cap dans le tumulte du nouveau désordre mondial dans lequel le rapport de forces et les relations transactionnelles sont privilégiés sur la coopération. Après une jeunesse marquée par la bipolarité de la guerre froide, puis une maturité vécue sous l’hégémonie unipolaire des États-Unis, l’Organisation peine aujourd’hui à s’adapter à un nouveau monde. Les rivalités géopolitiques paralysent le Conseil de sécurité, la montée des populismes va à l’encontre de la solidarité internationale, et les innovations technologiques creusent encore les inégalités entre pays riches et pauvres. Confrontée à une crise financière, l’ONU va couper 20% de ses effectifs d’ici 2026 et pourrait avoir à effectuer de nouvelles coupes si l’administration Trump refuse de payer sa part du budget.
L’ONU semble donc condamnée à « faire différemment avec moins ».
Le désordre mondial affaiblit le rôle politique du Secrétaire général et de ses envoyés spéciaux, tout en alimentant une double crise – de légitimité et de pertinence – qui frappe l’ONU en Afrique ou elle était très présente ces dernières décennies, mais aussi en Ukraine et au Moyen-Orient, des crises dans lesquelles elle ne joue qu’un rôle secondaire et avant tout humanitaire. Les principes, normes et valeurs qui ont guidé l’Organisation sont contestés par un nombre croissant d’États y compris parmi les plus puissants qui souhaite un retour aux fondamentaux de l’Organisation sur lesquels ils ne s’accordent pourtant pas. Et malgré tout, tous les États puissants et moins puissants se sont retrouvés à nouveau pour la 80e Assemblée générale des Nations unies en septembre à New York. Car l’ONU demeure une tribune importante et la seule enceinte réunissant 193 États membres qui peuvent y discuter d’enjeux véritablement globaux, en témoigne la résolution adoptée en aout marquant un premier pas sur la gouvernance de l’IA.